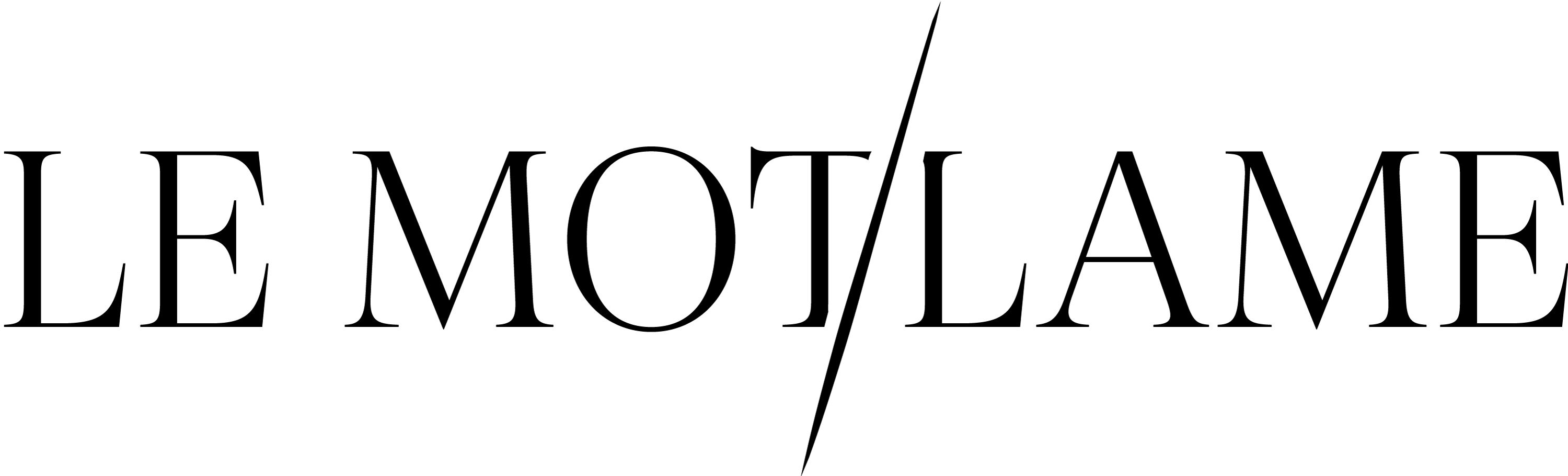Un texte signé Jean Genet
Les chefs‑d’œuvre artistiques ou poétiques sont la plus haute forme de l’esprit humain, son expression la plus convaincante : voilà un lieu commun qu’on se doit de conserver sous le titre de vérité éternelle. Qu’ils soient la plus haute forme de l’esprit humain, ou la forme la plus haute donnée à l’esprit humain, ou la plus haute forme prise, patiemment ou vite, par un coup de pot, toujours hardiment si l’on veut, il s’agit d’une forme, et cette forme est loin d’être la limite où peut s’aventurer un homme.
Passons à Dostoïevski ou plutôt aux Frères Karamazov, chef‑d’œuvre du roman, grand livre, audacieuse instigation des âmes, démesure et démesures. Cette manière de considérer c’est aussi la mienne, à quoi s’ajoute une envie de rire en face de la fausse et très réelle imposture que constitue le destin de ce livre. Enfin Dostoïevski réussit ce qui devait le rendre souverain : une farce, une bouffonnerie à la fois énorme et mesquine, puisqu’elle s’exerce sur tout ce qui faisait de lui un romancier possédé, elle s’exerce contre lui-même, et avec des moyens astucieux et enfantins, dont il use avec la mauvaise foi têtue de saint Paul.
Il est possible, s’il portait en lui ce roman depuis plus de trente ans, il est possible qu’il ait voulu l’écrire sérieusement, c’est-à-dire comme Crime et Châtiment ou L’Idiot, mais en cours d’écriture, il a dû sourire, peut-être à propos d’un de ses procédés, puis sourire de Dostoïevski romancier, et enfin se laisser emporter par la jubilation. Il se jouait un bon tour.

Peu au fait des procédés de compositions romanesques, je ne sais toujours pas si un écrivain commence un livre par son début ou par sa fin. Dans le cas des Frères Karamazov, il m’est impossible de discerner si Dostoïevski a voulu débuter par la visite de la famille Karamazov au Staretz Zozine mais dussé-je attendre la mort et la puanteur du Staretz, dès ce moment déjà j’ai la puce à l’oreille.
Tout le monde attend un miracle : il y a son contraire, le cadavre au lieu de rester intact, ce qui aurait été la moindre des choses, le cadavre pue. Alors, avec une sorte d’acharnement délicieux, Dostoïevski va tout faire pour nous déconcerter ; on attend que Grouchegnka soit une salope : chez Katia lvanovna, Aliocha voit d’abord une belle jeune fille, apparemment très bonne et très généreuse, et dans son emportement, gratitude et tendresse, Katerine lvanovna lui baise la main. Bouleversée, Grouchegnka porte à son tour la main de Katerine lvanovna près de sa bouche, éclate de rire et insulte sa rivale. Humiliée, Katerine chasse Grouchegnka.

Quand Aliocha rentre au monastère, le cadavre du Staretz sent de plus en plus, il a fallu ouvrir les fenêtres. Aliocha sort. Dans la nuit il se jette sur le sol, embrasse la terre. Il prétend même avoir été visité à ce moment-là, et il finit, avec son froc de moine, dans l’appartement de Grouchegnka. Ce qui permet à Aliocha de rester pur, on le sait, c’est son sourire dans toutes les occasions où un autre à sa place serait troublé : encore moine, quand Lise lui envoie un billet et décide de l’épouser, il sourit et accepte très sérieusement de devenir son mari. Plus tard, quand le jeune garçon Kolia lui dit : « en somme, Karamazov, vous et moi, nous sommes amoureux l’un de l’autre », Aliocha rosit un peu, sourit, et approuve. Aliocha sourit, il a vingt ans. Un amusement semblable, à soixante ans, fait sourire Dostoïevski : un geste ou un autre peuvent être interprétés comme on veut. Le Procureur, au tribunal, explique les mobiles de Dimitri Karamazov et l’avocat, aussi sagace, leur donne un sens inverse.
Tout acte a donc une signification et la signification inverse. Pour la première fois, il me semble, l’explication psychologique est détruite par une autre (contraire) explication psychologique. Les actes ou les intentions qu’on a l’habitude – dans les livres et même dans la vie quotidienne – de considérer comme néfastes aboutissent à ce sauvetage, et les actes et intentions charmants provoquent la catastrophe. Kolia élève un chien que le petit Ilioucha a cru empoisonner ou faire mourir avec une épingle. Ilioucha devenu malade n’espère qu’en l’arrivée de Kolia, et au retour du chien, Kolia enfin rend visite à Ilioucha et ramène le chien : la joie d’Ilioucha est si forte, qu’il en meurt.

L’attitude de dilettante, sûr de soi, d’Ivan Karamazov, fait proférer à Dimitri des paroles, et mêmes des actes, contre son père, qui le conduiront en Sibérie.
Au début du procès, Ivanovna parle avec chaleur de Dimitri ; un quart d’heure après, elle lit une lettre de Dimitri au tribunal : Dimitri est condamné.
Dostoïevski montre une hargne à l’égard du socialisme, et la même à l’égard de la psychologie.
Contre le socialisme il est féroce (voir les scènes où Kolia, par son comportement, ridiculise le socialisme), mais une fois de plus il faut que le grain meure : c’est une révolution socialiste qui permet aujourd’hui à des millions de Russes de lire Dostoïevski.
Avec la psychologie, il s’y prend bien : au lieu, comme dans ses autres romans, de donner seulement une explication sérieuse des mobiles, il donnera encore l’explication inverse : résultat, à la lecture, tout, personnages, événements, tout était ceci et son contraire, il ne reste que de la charpie. L’allégresse commence. La nôtre et celle du romancier. Après chaque chapitre on est fixé : il ne reste plus rien de vrai. Alors, c’est un Dostoïevski nouveau qui apparaît : il bouffonne. Il s’amuse à donner une explication positive des événements, puis sans doute s’apercevant que cette explication dans le roman est vraie, il propose l’explication contraire.
Humour magistral. Jeu. Mais culotté parce qu’il détruit la dignité du récit. C’est le contraire de Flaubert qui ne voit qu’une explication et c’est le contraire de Proust qui accumule les explications, qui suppose un grand nombre de mobiles ou d’interprétations mais jamais ne démontre que l’explication contraire est admissible.
Ai-je mal lu Les Frères Karamazov ? Je l’ai lu comme une blague. Dostoïevski détruit ce que jusqu’à ce livre on considérait l’œuvre d’art avec affirmation, dignement.

Il me semble, après cette lecture, que tout roman, poème, tableau, musique, qui ne se détruit pas, je veux dire qui ne se construit pas comme un jeu de massacre dont il serait l’une des têtes, est une imposture.
On parle beaucoup ces temps-ci du rire des dieux. L’œuvre d’art construite sur de seules affirmations jamais contrariées est une imposture qui cache quelque chose de plus important. Franz Hals a dû bien rire avec Les Régentes et Les Régents. Rembrandt aussi avec la manche de La Fiancée juive. Mozart composant sa Messe de Requiem et même Don Juan. Tout leur était permis. Ils étaient libres. Et Shakespeare avec Le Roi Lear. Après avoir eu du talent et du génie, ils connaissent autre chose de plus rare : ils savent rire de leur génie.
Et Smerdiakov ?
Parce qu’ils sont quatre, les trois fils Karamazov. Le tendre, le chrétien Aliocha n’a pas une parole, il ne fait pas un geste indiquant que ce larbin est son frère.
Je voudrais parler de Smerdiakov.
L’Ennemi déclaré, Gallimard, août 1991
(texte écrit à une date non déterminée entre 1975 et 1980,
remis aux éditions Gallimard en 1981 et publié par la NRF en octobre 1986).