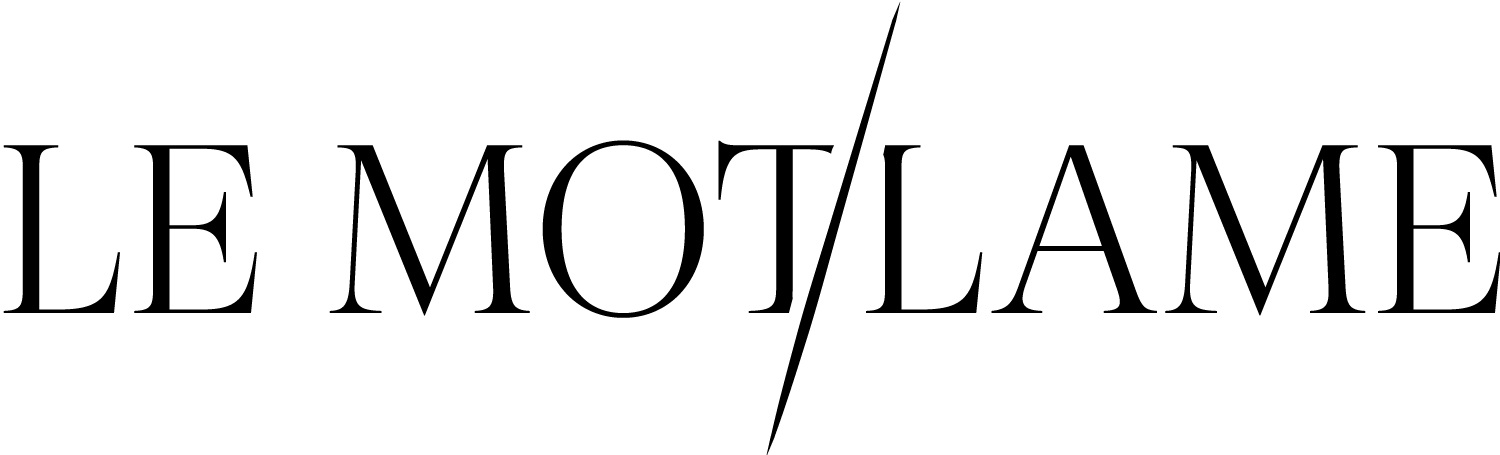Le court-métrage documentaire d’Alain Resnais & Chris Marker pose une question ; « Pourquoi l’art africain est exposé au musée de l’Homme et l’art grec au Louvre ? », Sorti en 1953, le propos du film révèle l’orientation diffusionniste de l’art moderne.
« Voici la mort d’un animal. Où est passée la force qui habitait cette main ? Elle est libre maintenant, elle rôde, elle va tourmenter les vivants jusqu’à ce qu’on la recueille dans son ancienne apparence. C’est à elle que s’adresse le sang du sacrifice, et c’est elle que l’on fixe dans ses métamorphoses légendaires, pour l’apaiser, jusqu’à en faire ces visages victorieux qui réparent le tissu du monde. »
Chris Marker & Alain Resnais, les statues meurent aussi ( 1953 )


Déjà, il faut se rappeler qu’en 1953 la pensée coloniale est triomphante. Deux ans avant la Guerre d’Algérie et la conférence de Bandung1 Acte par lequel les pays dits du « tiers-monde » ont concrètement commencé à lutter pour leur existence en tant que nations, on est aux balbutiements des mouvements décoloniaux. La nécessité du présent documentaire est vitale. Il est commandé par la revue Présence Africaine.
Quand on parlait plus haut de diffusionnisme culturel, cela renvoyait à une théorie d’ethnologie selon laquelle une culture dominante se diffuse au détriment des autres. En fait, avant 1949 et les travaux quoique critiquables de Claude-Lévi-Strauss, l’intelligentsia ne s’intéresse que très peu aux sociétés d’Afrique noire. On parle de sociétés « sans écriture », d’une civilisation « non historique » si l’on en croit Hegel. Donc par rapport à 1953, le documentaire auquel on va s’intéresser se situe sur une frange de l’avant-garde totalement radicale.
On est en droit de se demander ce qu’il en est maintenant que les études décolonniales ont les faveurs de l’université et des institutions. Les enjeux mis en lumière par ce documentaire sont-ils toujours d’actualité ?

« Pourquoi l’art africain est exposé au musée de l’Homme et l’art grec au Louvre ? »
Cette question implique une réflexion préliminaire : déjà pourquoi dans un musée ? À la base, ces objets étaient-ils artistiques ? Peut-être pas.
Certes, on n’expose pas que des œuvres d’art dans les musées, c’est aussi une institution qui collecte des traces de l’histoire humaine. Cela dit, il y a quelque chose de scabreux dans le fait d’y exposer des objets non occidentaux et éventuellement non artistiques.
Les statues africaines meurent deux fois.
Elles meurent parce qu’elles ont été volées, qu’on se le dise. Ensuite parce qu’elles appartiennent à une réalité cultuelle que l’occident ignore ou méprise. Elles n’ont pas seulement été volées à un monde, elles ont été arrachées à une certaine façon d’habiter ce monde, de le comprendre, de le représenter. Ces objets n’appartiennent pas à l’espace culturel auquel on les a greffés a posteriori et n’ont rien à faire dans des musées.
« Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des noirs : au musée. »
Chris Marker & Alain Resnais, les statues meurent aussi ( 1953 )
Dans un musée, exposés comme les butins de divers pillages, dans une mise en scène où va se déployer toute une imagerie du primitif non occidental, ces objets, nous occidentaux, les regardons pour y voir un reflet de notre propre passé. Nous les plaçons de sorte à justifier notre narratif évolutionniste : il y a d’un côté les sociétés primitives à l’âge des statues en bois et des poupées de chiffon, de l’autre l’occident qui va du David de Michel-Ange à l’art contemporain. Donc notre culture est la référence en matière de temporalité culturelle. Elle détermine ce qui est moderne et ce qui est primitif.
Il y a dans la « muséification » occidentale de l’art africain une mise à distance catégorique qui permet aux uns de situer leur identité culturelle par rapport aux autres. Prit sous cet angle, la présence africaine au sein de l’art moderne ne sert qu’à justifier des positions impérialistes. Ne parlons même pas du fait que ces objets sont issus de pillages.


Modernité, art moderne, colonialisme
La modernité, à travers le colonialisme, s’empare d’objets cultuels africains et les greffe dans un espace culturel où elles vont servir à justifier un discours impérialiste. Première mort. La modernité nous signale à travers son narratif impérialiste qu’elle a anéanti le culte d’où provenaient ces objets. Deuxième mort.
Nous évoquions une mise à distance catégorique. Notons à cet endroit que la « muséification » de l’art africain c’est-à-dire « la promotion » d’objets « primitifs » au rang d’objets artistiques ne signifie aucune avancée en histoire de l’art. Quand on sait que cette discipline s’intéresse avant tout à son seul espace historique, on comprend ce dont il est question dans l’exposition de ces statues. Qu’elles soient au Louvre ou au quai Branly, exposer des statues africaines ce n’est pas réhabiliter le système de pensée ou de culte d’où proviennent ces objets. Il s’agit uniquement de les situer dans notre tradition artistique, de les assimiler à notre propre histoire, toujours rétrospectivement.
L’art noir : nous le regardons comme s’il trouvait sa raison d’être dans le plaisir qu’il nous donne. Les intentions du noir qui le crée, les émotions du noir qui le regarde, cela nous échappe. Parce qu’elles sont écrites dans le bois, nous prenons ses pensées pour des statues. Et nous trouvons du pittoresque là où un membre de la communauté noire voit le visage d’une culture.
Chris Marker & Alain Resnais, les statues meurent aussi ( 1953 )
La problématique dont il est question est imbriquée dans le biais moderniste qui sépare réalité cultuelle et réalité culturelle.
Cette séparation remonte au 16e siècle, quand la modernité, par son acte de naissance ; la révolution copernicienne instaure une rupture radicale entre le monde de la tradition et le monde de la technique. La modernité s’ouvre sur un univers cartésien qui place l’homme occidental en situation de démiurge par la même occasion que la modernité se referme à un ensemble de systèmes qui ne se soumettent pas à la rationalité instrumentale. Après que le Moyen-Âge ait été orienté par la foi, la croyance et les dimensions existentielles de l’expérience humaine. il s’agit désormais de réduire le possible au faisable. Le pragmatisme adapte les moyens scientifiques modernes aux fins visées. Ce qui ne peut être prouvé est relégué dans le domaine de l’imaginaire, du spirituel, du primitif.

Maintenant, quand nous parlons de mise à distance catégorique, entendons ceci : la modernité fixe les conditions d’une expérience, en l’occurrence, l’histoire de l’art, afin de mettre en évidence ce qui fut préalablement conçu, à savoir l’idée que l’art occidental moderne et post-moderne représente la fin de l’histoire. Son stade le plus abouti. Prééminent sur le reste du monde. Dès lors la méthode (l’historicité de l’art) fixe les conditions et les critères d’appréciations de l’expérience (l’histoire de l’art) qui n’a plus pour seul but que de ramener l’ensemble des paramètres du sujet (l’art) pour que l’on y trouve ce que l’on est venu y chercher.
En résumé, ce que « l’histoire de l’art » considère comme contemporain ou primitif est déjà biaisé par l’appréciation moderniste qui relègue le cultuel et le spirituel au rang du primitif. Il n’est donc pas étonnant que les musées d’art moderne représentent et justifient ce système de classification sans le questionner.
Quelle musique berçait cette petite princesse, cette petite orange murie dans les caves du Bénin ? Quel culte présidait cette petite Republique de la nuit ? Nous n’en savons rien. Ces grands empires sont les royaumes les plus morts de l’histoire. Contemporains de Saint Louis, de Jeanne d’Arc, ils nous sont plus inconnus que Sumer et Babylone.
Chris Marker & Alain Resnais, les statues meurent aussi ( 1953 )
Qu’en est-il aujourd’hui ?
On peut reprocher aux musées de posséder des objets volés durant la colonisation et exiger restitution, mais plus personne ne peut légitimement dénoncer le fait que des artefacts cultuels ont été réduits au rang d’objets d’art, ceci dans la mesure où la réalité cultuelle dont il est question a disparue de sa Terre natale ou n’y subsiste qu’à travers une sorte de tourisme spirituel organisé par des locaux pour des Occidentaux. Restituer les statues ne les fera pas renaître. Les remettre à leur place, que ça soit dans un musée ou un temple, ce sera toujours les regarder à travers un regard occidental. Les statues africaines sont mortes avec le monde dont elles étaient l’image. De ce monde, comme des statues, il ne reste que des imitations tout à fait désolantes.
NM