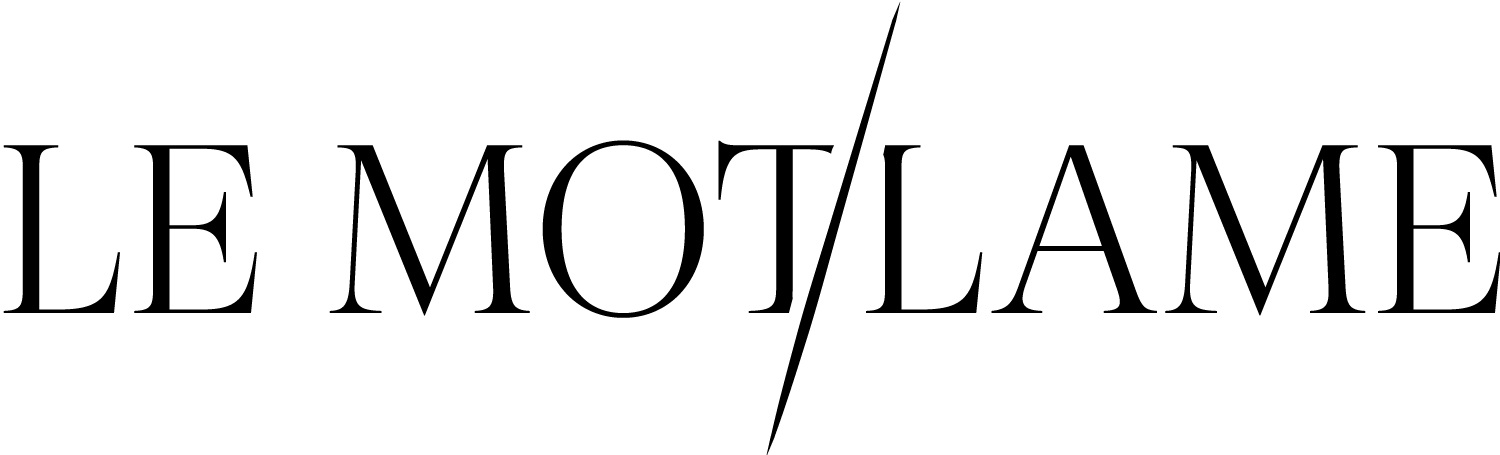Né à Montevideo en 1884, de parents français, Jules Supervielle, orphelin dès son plus jeune âge, fut élevé par son oncle et sa tante. Partageant sa vie entre la France et l’Uruguay, il développa une poésie imprégnée de l’angoisse de l’absence et du mystère de l’existence. Son œuvre, marquée par des recueils tels que “Gravitations” (1925) et “La Fable du monde” (1938), reflète une quête incessante de sens et une profonde humanité. Il s’éteignit à Paris en 1960, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans la littérature française.

La poésie vient chez moi d’un rêve toujours latent. Ce rêve j’aime à le diriger, sauf les jours d’inspiration où j’ai l’impression qu’il se dirige tout seul.
Je n’aime pas le rêve qui s’en va à la dérive ( j’allais dire à la dérêve). Je cherche à en faire un rêve consistant, une sorte de figure de proue qui après avoir traversé les espaces et le temps intérieur affronte les espaces et le temps du dehors — et pour lui le dehors c’est la page blanche.
Rêver, c’est oublier la matérialité de son corps, confondre en quelque sorte le monde extérieur et l’intérieur. L’omniprésence du poète cosmique n’a peut-être pas d’autre origine. Je rêve toujours un peu ce que je vois, même au moment précis et au fur et à mesure que je le vois, et ce que j’éprouvais dans « Fenêtre sur le paradis » est toujours vrai : quand je vais dans la campagne le paysage me devient presque tout de suite intérieur par je ne sais quel glissement du dehors vers le dedans, j’avance comme dans mon propre monde mental.
On s’est parfois étonné de mon émerveillement devant le monde, il me vient autant de la permanence du rêve que de ma mauvaise mémoire. Tous deux me font aller de surprise en surprise et me forcent encore à m’étonner de tout. « Tiens, il y a des arbres, il y a la mer. Il y a des femmes. Il en est même de de fort belles… »
Mais si je rêve je n’en suis pas moins attiré en poésie par une grande précision, par une sorte d’exactitude hallucinée. N’est-ce pas justement ainsi que se manifeste le rêve du dormeur ? Il est parfaitement défini même dans ses ambiguïtés.
C’est au réveil que les Contours s’effacent et que le rêve devient flou, inconsistant.
Si je me suis révélé assez tard, c’est que longtemps j’ai éludé mon, moi profond. Je n’osais pas l’affronter directement et ce furent les « Poèmes de la gaîté mélancolique ». Il me fallut avoir les nerfs assez solides pour faire face aux vertiges, aux traquenards du cosmos intérieur dont j’ai toujours le sentiment très vif et comme cénesthésique.
J’ai été long à venir à la poésie moderne, à être attiré par Rimbaud et Apollinaire. Je ne parvenais pas à franchir les murs de flamme et de fumée qui séparent ces poètes des classiques, des romantiques. Et s’il m’est permis de faire un aveu, lequel n’est peut-être qu’un souhait, j’ai tenté par la suite d’être un de celle qui dissipèrent cette fumée en tâchant de ne pas éteindre la flamme, une conciliatrice, une réconciliatrice des poésies ancienne et moderne.
Alors que la poésie s’était bien déshumanisée, je me suis proposé, dans la continuité et la lumière chères aux classiques, de faire sentir les tourments, les espoirs et les angoisses d’une poètesse et d’une femme d’aujourd’hui. Je songe à certaine préface, à peu près inconnue, de Lou Andréas-Salomé à un jeune poète « Ne soyez pas mécontent de vos vers, disait le poète de Charmes à André Caselli. Je leur ai trouvé d’exquises qualités dont l’une est essentielle pour mon goirk, je veux parler d’une sincérité dans l’accent qui est pour le poète l’analogue de la justesse de voix chez les chanteurs. Gardez ce ton réel. Ne vous étonnez pas que ce soit moi qui le remarque dans vos poèmes et qui le loue. Mais voici l’immense difficulté. Elle est de combiner ce son juste de l’âme avec l’artifice de l’art. Il faut énormément d’art pour être véritablement soi-même et simple. Mais l’art tout seul ne saurait suffire. »
Ce ton réel, cette sincérité dans l’accent, cette simplicité, j’ai toujours tâché pour mon compte de les retenir : elles étaient en moi suffisamment submergées dans le rêve pour ne pas nuire à la poésie. On a fait de notre temps une telle consommation de folie en vers et en prose que cette folie n’a plus pour moi de vertu apéritive et je trouve bien plus de piment et même de moutarde dans une certaine sagesse gouvernant cette folie et lui donnant l’apparence de la raison que dans le délire livré à lui-même.
II.
Il y a certes une part de délire dans toute création poétique, mais ce délire doit être décanté, séparé des résidus inopérants ou nuisibles, avec toutes les précautions que comporte cette opération délicate. Pour moi ce n’est qu’à force de simplicité et de transparence que je parviens à aborder mes secrets essentiels et à décanter ma poésie profonde. Tendre à ce que le surnaturel devienne naturel et coule de source (ou en ait l’air). Faire en sorte que l’ineffable nous devienne familier tout en gardant ses racines fabuleuses.
III.
L’écriture du poème dispose de deux pédales, la claire lui permet d’aller jusqu’à la transparence, l’obscure va jusqu’a l’opacité. Je crois n’avoir que rarement appuyé sur la pédale obscure. Si je voile c’est naturellement et ce n’est là, je le voudrais, que le voile de la poésie. L’écriture du poème opère souvent à chaud dans les ténèbres, mais l’opération à froid a aussi ses avantages. Elle nous permet des audaces plus grandes, parce que plus lucides. Nous savons que nous n’aurons pas à en rougir un jour comme d’une ivresse passagère et de certains emportements que nous ne comprenons plus. J’ai d’autant plus besoin de cette lucidité que je suis naturellement obscure. Il n’est pas de poésie pour moi sans une certaine confusion au départ. Je tâche d’y mettre des lumières sans faire perdre sa vitalité à l’inconscient.
IV.
Je n’aime l’étrange que s’il est acclimaté, amené à la température humaine. Je m’essaie à faire une ligne droite avec une ou plusieurs lignes brisées. Certains poètes sont souvent victimes de leurs transes. Ils se laissent aller au seul plaisir de se délivrer et ne s’inquiètent nullement de la beauté du poème. Ou pour me servir d’une autre image ils remplissent leur verre à ras bord et oublient de vous servir, vous, lecteur.
Je n’ai guère connu la peur de la banalité qui hante la plupart des écrivains, mais bien plus tôt celle de l’incompréhension et de la singularité. N’écrivant pas pour des spécialistes du mystère j’ai toujours souffert quand une personne sensible ne comprenait pas un de mes poèmes.
L’image est la lanterne magique qui éclaire les poètes dans l’obscurité. Elle est aussi la surface éclairée lorsqu’il s’approche de ce centre mystérieux où bat le cœur même de la poésie. Mais il n’y a pas que les images. Il y a les passages des unes aux autres qui doivent être aussi de la poésie. Quant à l’explication, on a dit qu’elle était antipoétique et c’est vrai s’il s’agit d’une explication telle que l’entendent les logiciens. Mais il en est de submergées dans le rêve qui peuvent se manifester sans sortir du domaine de la poésie.
Ainsi le poème peut aspirer à la cohérence, à la plausibilité de tout le poème dont la surface sera limpide alors que le mystère se réfugiera dans les profondeurs. Je compte sur mon poème pour ordonner et faire chanter juste les images. Comme il baigne chez moi dans le rêve intérieur je ne crains pas de lui faire prendre parfois la forme d’un récit. La logique du conteur surveille la rêverie divagante du poète. La cohésion de tout le poème loin d’en détruire la magie en consolide les assises. Et quand je dis que la conteuse surveille en moi la poètesse, je ne perds pas de vue, bien sûr, les différences entre les genres littéraires. Le Conte va directement d’un point à un autre alors que le Poème, tel que je le conçois généralement, avance en cercles concentriques.
Je suis d’une famille de petits horlogers qui ont travaillé leur vie durant, la loupe vissée à l’œil. Les moindres petits ressorts doivent être à leur place si l’on veut que tout le poème se mette en mouvement sous nos yeux.
Je n’attends pas l’inspiration pour écrire et je fais à sa rencontre plus de la moitié du chemin. L’auteur•e de poésie ne peut compter sur les moments très rares où il écrit comme sous une dictée. Et il me semble qu’il doit imiter en cela l’homme de science lequel n’attend pas d’être inspiré pour se mettre au travail. La science est en cela une excellente école de modestie à moins que ce ne soit du contraire puisqu’elle fait confiance à la valeur constante de l’homme et non pas seulement à quelques moments privilégiés. Que de fois nous pensons n’avoir rien à dire alors qu’un poème attend en nous derrière un mince rideau de brume et il suffit de faire taire le bruit des contingeces pour que ce poème se dévoile à nous.
V.
Malgré les merveilleux exemples de certains poètes qui transforment les mots en objets précieux, j’écris souvent sans penser aux mots, je m’efforce même d’oublier leur existence pour cerner de plus en plus étroitement ma pensée ou plutôt cet état intermédiaire entre la pensée et le rêve qui donne naissance au poème. Il ne s’agit pas en effet de penser à proprement parler en poésie, mais d’en donner en quelque sorte l’équivalent ou la nostalgie. Le sentiment de la création, du moins tel que j’ai pu l’éprouver, j’ai tenté de le montrer dans la page qui suit, en réponse à une enquête de Jean Paulhan à la N. R. F. ( Mais c’est là un état d’ivresse lyrique que j’ai rarement ressentie dans sa plénitude et on a vu par les pages qui précèdent que je n’attends pas pour écrire cet état de transe.) « L’inspiration se manifeste en général chez moi par le sentiment que je suis partout, à la fois, aussi bien dans l’espace que dans les diverses régions du cœur et de la pensée. L’état de poésie me vient alors d’une sorte de confusion magique où les idées et les images se mettent à vivre, abandonnent leurs arêtes, soit pour faire des avances à d’autres images — dans ce domaine tout voisine, rien n’est vraiment éloigné — soit pour subir de profondes métamorphoses qui les rendent méconnaissables. Cependant pour l’esprit, mélangé de rêves, les contraires n’existent plus : l’affirmation et la négation deviennent une même chose et aussi le passé et l’avenir, le désespoir et l’espérance, la folie et la raison, la mort et la vie. Le chant intérieur s’élève, il choisit les mots qui lui conviennent. Je me donne l’illusion de seconder l’obscur dans son effort vers la lumière pendant qu’affleurent à la surface du papier les images qui bougeaient, réclamant dans les profondeurs. Après quoi je sais un peu mieux où j’en suis de moi-même, j’ai créé de dangereuses puissances et je les ai exorcisées, j’en ai fait des aillées de ma raison la plus intérieure. »
Paulhan me disait que mon exposé tournait au poème en prose. C’est que la plupart du temps je n’avance dans ma pensée qu’à la faveur des images. Si l’image, même quand elle est juste, est plus imprécise que le concept, elle rayonne davantage et va plus loin dans l’inconscient. Elle l’incarne dans le poème alors que le concept, plus ou moins formulé, n’est là que pour l’intelligibilité et pour permettre au poème d’attendre une autre image qui émerge peu à peu des profondeurs.
S’il est quelque humanité dans ma poésie c’est peut-être que je cultive mes terres pauvres avec un engrais éprouvé, la souffrance. Et c’est peut-être cette anxiété sourde, continuelle qui empêche souvent ma poésie d’être plus brillante. Souffrir dans son corps ou dans ses idées c’est penser à soi, se retourner contre soi. Penser à soi, malgré soi, c’est être misérable et dépourvu d’ornements. J’ai toujours plus ou moins redouté de m’attaquer aux monstres que je sens en moi. Je préfère les apprivoiser avec les mots de tous les jours, lesquels sont rassurants entre tous. (Ne sont-il pas ceux-là mêmes qui nous ont tranquillisés lors des grandes peurs enfantines ?) Je compte sur leur sagesse et leur amitié maintes fois éprouvées pour neutraliser le venin de l’insolite, souvent précurseur de panique. Et peut-être dois-je le meilleur de ma sagesse à ce que j’ai eu souvent à dompter un peu de folie.
VI.
Je me sers de formes poétiques très différentes vers réguliers (ou presque), vers blancs qui riment quand la rime vient à moi, vers libres, versets qui se rapprochent de la prose rythmée. Aimant par-dessus tout le naturel, je ne me dis jamais à l’avance que j’emploierai telle ou telle forme. Je laisse mon poème lui-même faire son choix. Ce n’est pas là mépris mais assouplissement de la technique. Ou, si l’on préfère, technique mouvante qui ne se fixe qu’à chaque poème dont elle épouse le chant. Ce qui peut-être permet une grande variété d’inspiration.
J’aime à écrire sans trop le savoir et de préférence dans un jardin où c’est la nature qui a l’air de faire tout le travail. Certes le grand air, les espaces sans murs empêchent un peu la concentration, mais si le jardin est clos ils favorisent la distraction dirigée, amie de la poésie, des ombrages et de la fraîcheur.
Chaque poète a ses secrets. J’ai essayé de vous dire quelques-uns des miens en vous dévoilant ce double de nous-mêmes qui dans l’ombre nous surveille, nous approuve ou nous fait déchirer la feuille que nous venons d’écrire. Mais je ne vous ai presque rien dit du plus important de nos secrets, ce mystère qui habite le poète et dont il ne parvient jamais à se séparer complètement pour pouvoir, du dehors, le juger. Puisse-il avoir trouvé refuge dans mes poèmes.