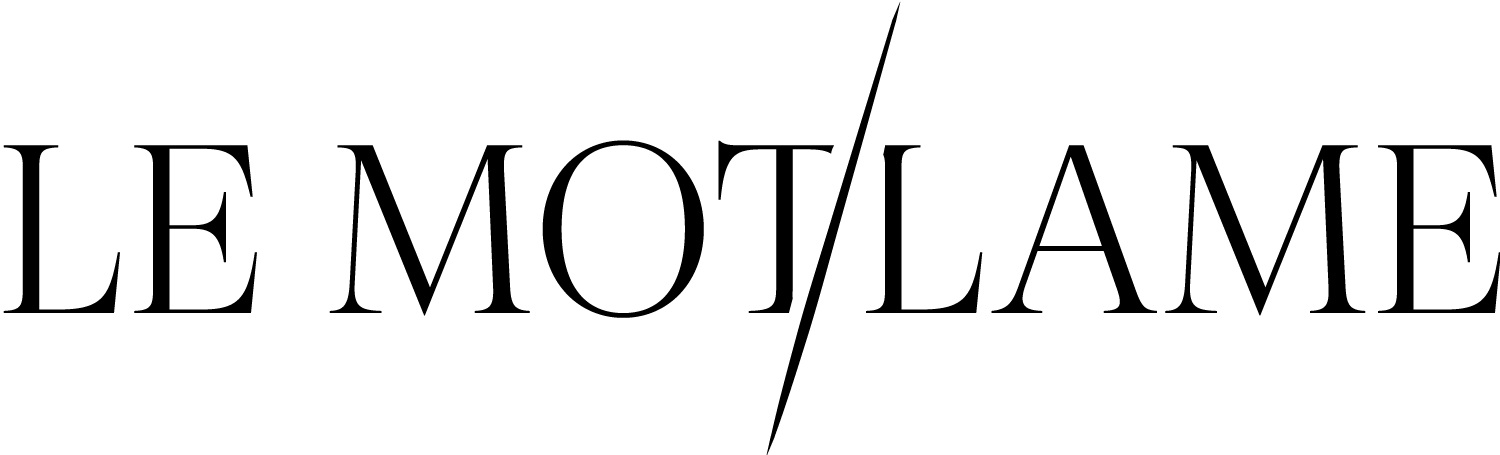Souvent j’ai marché pour me perdre. En suivant la foule, j’arrive toujours face au souk. Il fait nuit. Sur une longue allée commerçante, des passants, des étalages, des motos taxis, une fourmilière où chacun traverse dans une direction différente, devient son propre sens de circulation, diagonal, inverse. Sur la chaussée large de cinq mètre, les camions et autres véhicules circulent entre les piétons. Sous des parasols, on vend des piles électriques, des chaises, des sandales, des recharges téléphoniques, des chaussettes. Au bord du trottoir, à ciel ouvert, les caniveaux, comme de petits ruisseaux noirs où se promène l’odeur des enfers. Les magasins donnent sur la rue, on entend la musique à fond les enceintes. Je vais d’un refrain à l’autre, entrecoupé du son d’un mégaphone où une voix enregistrée répète : cartes mémoires, services informatiques, recharges téléphoniques. Dans un pays où le ramassage des ordures est un mensonge d’état, on ramasse les emballages, les bouteilles en plastique, les sacs, des bouts de bois, et on allume des feux. Les déchets du jour partent en fumée, font place aux déchets de demain, qui seront brûlés à leur tour. J’avance sur une allée noire de monde, de présences, il fait nuit, je suis sur le plus vieux marché de Kin. La fumée des ordures autour de moi, les phares de motos qui sortent de nulle part, la pollution à fleur de peau, des sourires, des regards, des dents, la nuit. Autour de moi, les flammes. Je marche. Des gens s’engueulent, comment font-ils pour se reconnaître ? Je ne vois que des ombres. À chaque pas, la foule se densifie, c’est comme s’enfoncer dans une charogne peuplée de fourmis et de larves. Mon regard s’arrête parfois sur des détails absurdes. Deux vieillards sont assis autour d’un plateau d’échec. Capsules de bière retournées, capsules de bière pas retournées, il jouent aux dames. Un tas d’ordures se met à bouger seul. Un monstre qui parle et se déplace. C’est un enfant qui amène les déchets au feu, il les portes sur ta tête, il doit avoir cinq ans. Un fantôme me fonce dessus, je vois voler un long drap blanc. C’est un homme qui vend une moustiquaire, il la présente en marchant à l’intérieur. À plusieurs reprises, j’évite de me faire arracher la hanche par le rétroviseur d’un taxi. Il faut danser un peu pour ne pas mourir. Des grands-mères continuent à vendre du manioc malgré le soir. Sur des chaises et quelques lattes de bois, elles s’éclairent à la bougie, je ne vois que les visages, les regards, le reflet des flammes sur leurs lunettes. Au milieu des embouteillages, un homme debout sur le toit d’une camionnette comme sur une planche de surf évalue le trafic. Et la musique des terrasses, des mégaphones, de la vente à la criée, des klaxons. Et la nuit, la fumée, les bougies, les ordures qui partent en flammes, l’odeur du plastique brûlé. Kinshasa. 3,4 millions de personnes ont fuit les villages en guerre vers la capitale. Dans les rues on vend : haricots en sachets, montres, cartes des vingt-six provinces, chats, cigarettes, perroquets, sommiers de lits, statuettes bantoues. La foule se dégage, j’inspire.
Chemin retour, moto-taxi, l’impression d’être en phase avec mon Dieu intérieur. Chacune des présences que j’ai traversées m’a transmis une incarnation, j’ai sentis en moi trembler les guerres et s’étendre les paysages, le chant des naissances et des morts, des présences qui se sont fondues à la mienne. Le conducteur se retourne, il ne parle pas français. Un coup d’épaule me signifie « accroche-toi, ça va secouer’. Nous sommes dans les rues de Kinshasa. L’heure des derniers commerces est passée.
N.