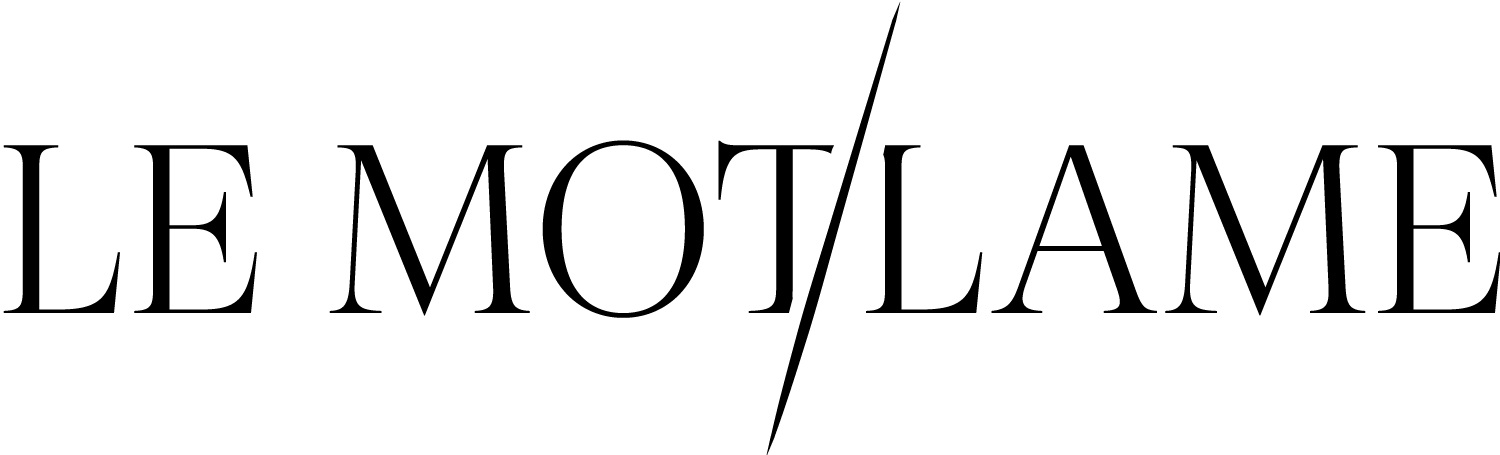Après mille années dans le passé j’avais enfin rejoint les rives du présent, là-haut, tout en haut du globe. Mon chemin avait été parsemé de fantômes. J’ai vu mille forets et mille cités, des châteaux et des ports et mille visages encore. J’ai vu le monde et les Hommes vieillir tout comme moi. Et chaque pas sur mon chemin m’était irréversible ; pourtant je revenais toujours aux mêmes lieux. J’ai souffert des guerres et des famines, oui, j’ai subi les massacres et les pogroms ; j’ai vu mes amis d’un siècle et d’un instant déporté là-bas au loin vers le pays des cannes à sucre ; j’ai vu des loups libres et fiers chassés à la carabine par de pitoyables paysans rougeaud, tout sur de leurs droits. J’ai vu des cathédrales en abattre d’autres ; j’ai vu les forêts qui firent Reims — je sais maintenant que les cathédrales ne sont que des forets de pierre ; une imitation grotesque, un palliatif futile aux cimes qui ne protègent plus. J’ai entendu tonner les canons en hommage au tonnerre de Brest. J’ai enjambé les cadavres buboniques — j’ai même creusé des caveaux pour certains de mes enfants. Il y eut mille tristesses sur mon chemin, et mille bonheurs encore, sans cesse répétés, renouvelés, détruits. Le temps érode même le retour éternel des choses : et à chaque fois quelques choses changeaient, des choses infimes pendant longtemps. J’ai marché des siècles dans le calme des bois, des vallées, des ruisseaux et des forets touffus, vierge, sauvage, sublime d’incohérences et d’imagination. Je croisé tous les dix ans un homme comme moi, et sa tribu. Qu’il était apaisant ce temps long et lent, qu’il était apaisant de croiser la vie partout – la vie jusque dans la mort. Les choses ont mis longtemps, très longtemps à changer. Puis un jour tout s’est accéléré. Ils se firent plus nombreux les hommes ; ils ont creusé, défriché, abattu et brûlé ! Ils ont ravagé jusqu’au sous-sol — j’ai vu dans ces pays en haut de long serpent de fer avaler des peuples entiers et des oiseaux de fer fracasser les cieux avec l’orgueil de laisser derrière eux de droites lignes qui singent les nuages. Et bientôt leurs cités avaient recouvert le monde — tout n’était plus que gris et droit. Ils avaient tué l’imagination. Je les ai vus grouillants comme des rats dans une immense décharge. Je les ai vus se noyer dans des mers. L’homme avait perdu toute fierté. Il était bien trop nombreux c’est pour cela qu’il a voulu disparaître. Sa rage même est devenue telle qu’il a multiplié les outils pour tuer ce qui l’entoure. Après avoir vidé les mers et les cieux, après s’être repu des tous les quadrupèdes, après avoir tué jusqu’à la fertilité des sols, sa rage s’est d’autant plus vivement retourné contre lui-même.
L’Homme avait même donné un nom au cours technique de ses meurtres incessants : il l’a appelé progrès. De progrès en progrès, il redevint cannibale. Des peuples entiers s’entredévorent au milieu des poubelles. De vieux messieurs très dignes se changèrent en monstres froids et assoiffés et rien ; plus rien du vieux monde que j’avais parcouru pendant tant de temps ne restait :
Le progrès avait fini de tout réduire : les odeurs et les couleurs amoindries en une gamme industrielle — les animaux et les arbres devenus domestiques. Ils avaient tué la douceur de vivre en poursuivant le projet d’une vie plus douce. Ils se mirent à tout parler la même langue ; j’ai vu tant de mots mourir avec les choses qu’ils désignaient. Il n’y eut bientôt plus de mot, car il n’y eut bientôt plus d’expériences à vivre.
L’Homme devint semblable à ses démons et son monde devint semblable aux prédictions de ses peintres baroques. Voilà pourquoi nous l’avons remplacé. Voilà pourquoi nous l’avons surmonté.