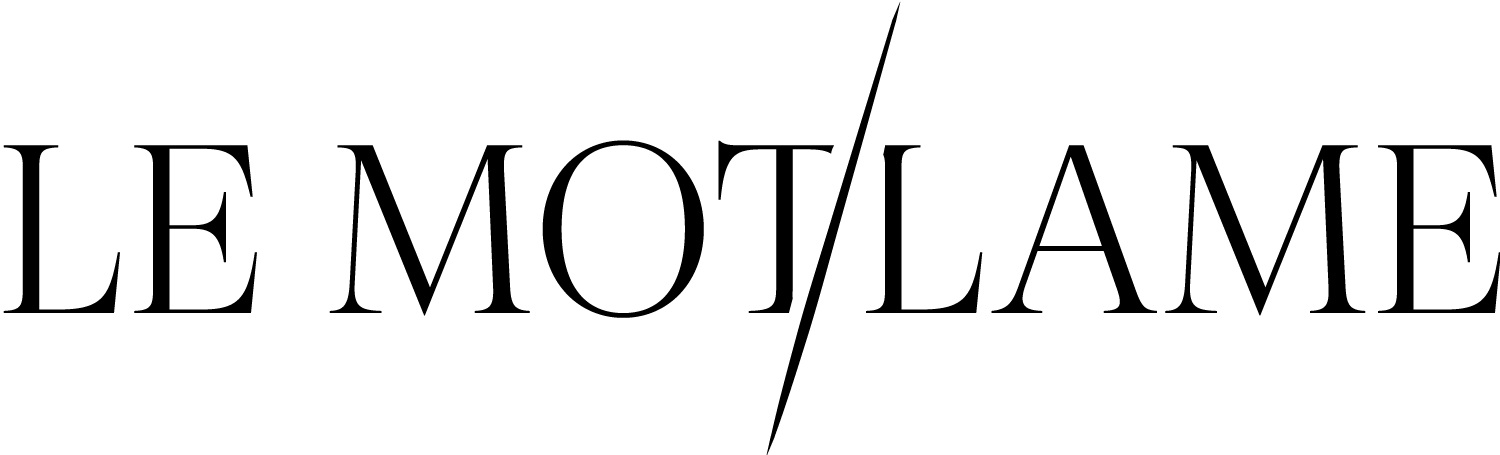Un texte signé Monia Aljalis.
Je suis venue collecter une mémoire. La mienne, déjà défaillante comme bon nombre de ceux de ma génération, n’imprime rien, ne retient rien : elle est traumatique par défaut. Je cherche à épingler un papillon sur une feuille de lave, un semi-Apollon qui frétille au sommet d’une montagne à deux pics. Ses ailes s’arrachent tandis que le souvenir se cache dans ses stries : les rides de ces vieillards basanés, les méristèmes des arbres ravagés et les dizaines d’histoires qu’ils contiennent gardent enfouis en eux ce qui reste de l’histoire de ce pays : des ruines, comme toutes les autres histoires de tous les autres pays. Les vieillards meurent chaque jour par centaines, les arbres brûlent par milliers : l’angelus novus doit être calmé.

C’est la saison des antiques Neptunales. Ce rite d’hommage estival s’est conservé ici depuis l’époque romaine. On appelle ça Aoussou, une déformation d’Océan. Cela s’est calqué sur le calendrier berbère en aspirant tout ce qu’il pouvait trouver de traditions autour de lui. On fait entrer une Vierge dans l’eau le premier jour, on l’y lave : c’est le début de la saison de la baignade et la période la plus chaude de l’année. On fait parfois un carnaval et les gamins s’amusent au milieu des Boussadia, ces griots danseurs et musiciens qui effraient les mauvais esprits. Mon dernier jour ici marquera le dernier jour de cette période ; ce sera la première fois de l’année que je me baignerai. La madone sort de l’eau, j’y entre pour me purifier. J’arrive un jour de nouvelle lune, je repars au premier quartier. J’aime les temporalités régulières. J’aime les fins marquées, les cérémonies de départs. Je ne sais pas quand je reviendrai : peut-être dans un mois, peut-être dans deux ans, peut-être plus jamais.
Car je ne viens que pour collecter la mémoire de mon père. Le reste ne m’intéresse plus vraiment. Quand vous vivez au même endroit des années durant, que vous établissez vos quartiers, vos relations dans le même trou pour un temps, votre trace s’efface des lieux que vous hantiez auparavant. Le vent souffle sans discontinuer. Il ne reste qu’une sourde culpabilité. La mélancolie s’est emparée de mon sang : il a longtemps bouilli à la recherche d’un sens, il s’est embrumé des nuages de Paris et de France. Je n’ai plus la légitimité que j’affichais auparavant : quels commentaires voulez-vous faire quand vous venez une semaine tous les deux ans ? Mon arabe s’étiole à mesure que s’orne mon français ; j’ai plus de mal à saisir dans les inflexions de voix les subtilités de la pensée. Les copains ont beau me dire de revenir dans l’enthousiasme des vacances pour retrouver ma contrée : je me sens coupable de m’être intégrée, je hurle intérieurement de cet accent d’immigrée, je voudrais me cacher dans un trou et prier Dieu qu’il me pardonne de m’être oubliée.

Il y a pourrissement des racines. Pour sauver la plante, c’est l’heure de les couper. Il va falloir affirmer une identité : laissez-moi un peu de temps, de temps, de temps — et moi qui déteste la lenteur ! Pour les infos du coin, ouvrez un journal, vous en saurez plus que si vous me lisiez. Qu’un vieillard bégayant ait bloqué un pays entier pour son seul désir ; qu’on ait giflé et balayé une femme en plein Parlement sans que personne n’intervienne ; que la ville entière ait l’air d’un énorme champignon décomposé : je ne saurais comment l’expliquer. Tout m’a débordé : proprioception de fantôme. C’est tellement le bordel ici qu’il suffit de s’asseoir et d’observer ce qui se passe pour en sortir des lignes et des lignes — ce que j’ai fait à chaque fois que je venais jusqu’à maintenant. En une journée, j’ai vu un gars drifter dans un rond-point, des meutes de chiens s’attaquer pour une poubelle éventrée, des chevaux qui errent en bouffant du pain sec dans la rue, des culs d’une largeur de cargo dépasser de chaises en plastique cassées, des chats qui jouent au tennis, des bâtiments qui s’effondrent, des affrontements à coup de battes en bois d’olivier, 48 degrés à l’ombre tandis que je bois du thé avec ma tante, trois fois arrière grand-mère qui ne peut plus se déplacer. Je pourrais continuer comme ça pour un moment : j’aimais, il y a longtemps, souligner l’étrange caractère de ces scènes qu’on ne voit jamais nulle part ailleurs qu’ici. C’était mignon, nous avons bien rigolé. Cela suffit, il n’y a plus d’intérêt. C’est à ceux qui vivent ici de s’exprimer ; je ne volerai la pitance de personne.
Mon père fait office de phare : quand il parle de son vieux chameau ou de la gifle qu’a mangé Bardot, il y a comme une brise fraîche qui souffle sur mon dos trempé de sueur et de peine. J’ai tout enregistré, avec mes rires de petite fille gâtée par dessus. Voilà mon seul horizon. C’est dans sa mémoire et celle de tous ses copains qu’une forme de salvation pourra se trouver — la mienne, la vôtre, celle de tout le monde. Je me suis tatoué des roses des vents aux quatre coins du cerveau, c’est parti pour les sabliers. C’est désormais à la course solaire, aux traces, aux empreintes, aux vieilles histoires, enfin aux rires de ces derniers piliers d’un temple effondré, dans mon corps tous imprégnés grâce à ces longues heures au café, de m’affoler les synapses en dizaines de djinns frondeurs, avant que tout ne parte en fumée, inévitablement, sous le regard de Dieu et de son ange nouveau.
Extra ecclesiam nulla salus.
Monia Aljalis, vit et travaille à Paris